
Dans le cadre des rencontres culturelles et scientifiques, Supramuros, la Bibliothèque Universitaire propose, du 10 juillet au 30 septembre 2017, l’exposition Christian Petr, universitaire et homme de théâtre.
Il s’agit d’une exposition de textes et documents d’archives autour de l’oeuvre de Christian Petr. Professeur à l’Université d’Avignon et spécialiste de l’Inde, Christian Petr était également Président de l’association Les Amis de Roger Vailland et, Vice-président de la section avignonnaise des universités populaires du théâtre. Christian Petr était aussi auteur de nouvelles, de romans, d’essais et de textes pour le théâtre.
Discours pour Christian
(Conservatoire d’Avignon, 11 juillet 2016)
Je voudrais partager quelques images de Christian, des images lumineuses : ce sont des souvenirs personnels, mais chacun pourra retrouver dans ces images lumineuses le reflet fidèle de Christian.
Christian arrivant avec sa démarche légère et élégante dans la cafétéria de l’Université, entre deux rendez-vous ou entre deux cours : pas le temps de ressasser les vieux problèmes professionnels, mais du temps pour suggérer une rencontre, une solution ou pour lancer un projet, avant de repartir en lançant sa formule récurrente « À très vite ! »
Christian arrivant dans une réunion du département de lettres : prêt à tout entendre, devinant les pierres d’achoppement, mais trouvant les mots pour apaiser les tensions et rendre les débats plus constructifs. Son expérience de doyen de l’UFR Lettres et Sciences humaines a bien dû l’aider dans ce travail de diplomatie si délicat.
Christian me conduisant à une soutenance de thèse à Aix : grande discussion sur le théâtre, pour savoir si c’est un genre littéraire spécifique ou une forme d’expression tout à fait à part. Ouvert à toute idée différente, mais attaché à ses idées, les exprimant avec conviction et nuance à la fois.
Christian dans un jury de soutenance de master : une écoute et un dialogue bienveillants quelle que soit la qualité du travail présenté par le candidat, une évaluation juste et souple à la fois. Si Christian était si apprécié par ses étudiants, c’est sans doute parce que son enseignement était, à l’image de sa conversation et de sa personnalité, marqué par le sens de la nuance, le sérieux et l’humour à la fois, la compréhension et l’humanité d’un intellectuel humaniste, tolérant.
Christian dans une conférence de presse au Théâtre du Balcon chez son ami Serge : je le revois assis quelques rangs plus haut parmi les spectateurs, écoutant la présentation du programme du Festival Off 2015 ; quand le spectacle Marche construit à partir de son texte est évoqué, Christian reste tranquille et discret à sa place et on oublierait presque qu’il est l’auteur si Serge n’insistait pour le faire venir sur scène afin d’en parler : Christian y va tranquillement et légèrement comme d’habitude et en parle avec modestie et aisance à la fois, avouant sa curiosité et son intérêt pour le devenir scénique de ce texte pas spécifiquement théâtral à l’origine.
Quelques semaines plus tard, Christian dans le jardin du musée Angladon, assis en face de moi derrière la scène circulaire pour assister à cette création de Marche : grand moment poétique, grand moment d’émotion esthétique, partagé silencieusement chacun à une extrémité du diamètre, puis verbalement à l’issue du spectacle, avec la troupe de Serge.
Quelques semaines plus tard, Christian et Namita dans un dîner avec quelques amis au restaurant L’Italie là-bas : évocation de souvenirs universitaires, de voyages à Prague, d’expériences artistiques, autour d’un vin blanc délicieux, de mets italiens. Christian était aussi gourmand, savait goûter et apprécier la bonne cuisine, comme les autres bonnes choses de la vie. Conversation si agréable, légère ou profonde, spirituelle ou sérieuse selon les moments, jamais grave, jamais lourde, jamais pompeuse. Une conversation élégante, comme Christian. Anecdotes, images, idées fourmillaient dans sa conversation : on quittait ce repas avec l’impression d’avoir lu un livre sans difficulté, dans la grâce d’un moment d’amitié.
Toutes ces images qui demeurent reflètent la grâce de ces moments de partage : j’ai eu la chance, nous avons eu la chance, de les vivre ; dans la lecture ou la mise en scène des œuvres de Christian, nous aurons encore la chance de partager sa vision du monde ou sa curiosité à l’égard du monde. Paul Éluard nous y invite dans ses Derniers poèmes d’amour :
La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l’affirme,
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte,
Une fenêtre éclairée,
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler, Faim à satisfaire,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager.
PAUL ÉLUARD, « La nuit n’est jamais complète »
(dans Derniers poèmes d’amour)
Nathalie Macé, professeur à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Extraits d’ouvrages de Christian Petr
Eloge du traître
Judas s’impatiente. Depuis quelques mois, Jésus le menuisier tapine dans les villages de Galilée -« Viens, chéri, c’est l’amour qui passe» -et rien n’advient. Ce n’est pas que Christ, avec ses beaux yeux bleus, sa taille mince et ses longs cheveux dénoués sur les épaules, manque de clients, mais ceux-ci payent mal et, une fois consommé le miracle de l’amour, pensent vite à autre chose. Les finances de la petite troupe qui soutient le menuisier dans ses louches affaires sont donc mauvaises et Judas, le trésorier de la bande, se dit qu’au train où vont les choses l’aventure risque de mal tourner, c’est-à-dire de ne pas tourner du tout. L’œil rivé sur l’avenir, il ne voit pas même se dessiner le moindre petit scandale pour relancer le commerce car l’occupant romain lui-même se désintéresse de Christ qui reste inoffensif en soulageant comme il peut le malheur des pauvres. Seuls les prêtres s’inquiètent de son trafic. Alors Judas le clairvoyant, Judas le dialecticien qui, seul des douze, a compris que Jésus ne deviendra jamais roi, décide, afin que les choses avancent, de leur vendre le menuisier pour trente deniers -somme dérisoire, certes, mais fixée par le livre des comptes, et Judas est homme à respecter les livres (trop, sans doute, c’est là l’un de ses défauts). Judas donc trahit, non pour renflouer les caisses, mais afin que les Écritures s’accomplissent, que dieu rentre en luimême et que le monde remue.
N’allez pas croire que cet homme qui trahit Jésus par fidélité à dieu -dieu qui, mystérieusement, a trahi !’Esprit en s’incarnant en Christ – me soit, en dépit de ses incontestables qualités, absolument sympathique. J’aime Judas parce que, contre sa propre gloire, il choisit de faire bouger !’Histoire. Mais il a par trop, à mon goût, le sens de la faute. Ne va-t-il pas, son geste accompli, se faire pendre ailleurs – si du moins l’on en croit les petits contes qui rapportent son aventure? Et puis Judas est un homme qui démissionne. Lui qui, un temps, avait voulu faire de Christ un prince, lui qui, ange des ténèbres, avait choisi la vie et rien que la vie, la délaisse comme une souillon en condamnant Jésus à aller se faire voir dans la lumière glauque du divin. Misérable solution dont nous sommes tous, aujourd’hui encore, les victimes, car, en se mettant avec dieu, en attendant la mort pour que règne l’égalité, Judas le roux, Judas le pauvre à la tunique déchirée, choisit l’injustice. En lançant le christianisme, il réduit l’homme vrai au silence et inaugure la production en série du tout petit homme dont le rêve, sous des milliards de corps, est de n’avoir qu’une seule âme, dont l’ambition est de n’avoir jamais une pensée qui ne soit celle des autres, dont le désir est de ne jamais rien aimer ou haïr qui ne fût aimé ou haï par les autres.
On conclura de cette anecdote, et avec raison, que tous les traîtres ne se valent pas et qu’il en est de meilleurs que d’autres. C’est une simple question de bon sens.
La Fabrique de liberté [Re]lire Jaroslav Hasek
Chvéïk bavarde, et ses supérieurs, que cela irrite, entendent, sans y réussir, le faire taire. Pour autant, le roman tire son sérieux et sa drôlerie de ce bavardage.
Celui-ci, en effet, est une parole libre, en rien sujet aux contraintes qui spécifient les autres discours. Il autorise toutes les digressions, tous les coq-à-l’âne, conduit à prendre toutes sortes d’engagements, qui n’ont pas à être tenus.
C’est cependant en bavardant qu’on ne cesse de se refaire, et de refaire le monde.
De l’art sous X
D’abord, il y a la sauvage beauté de X qui, en la fatale rencontre de ses deux barres inclinées, récuse sur la feuille blanche le mot, abolit la chose.
J’avais quatorze ans. L’un de mes oncles, qui vivait aux États-Unis, remplaçait, quand il m’écrivait, la syllabe inaugurale de mon prénom par un « X» surprenant. Mes camarades s’étonnaient de cette manie. Je m’en émerveillais. Bien plus : la substitution bénigne priva peu à peu à mes yeux de toute existence symbolique le fils de Dieu. La lettre salvatrice supprima en moi le sens de la transcendance divine et m’ouvrit grandes les portes du royaume de l’immanent. De cette époque datent mon athéisme résolu et mon affection pour une lettre aux pouvoirs ambivalents puisqu’en effaçant elle avait révélé.
Jamais je ne porterai plainte contre X.
Quand, plus tard, je découvris cette lettre accolée au mot cinéma, quel espoir ne plaçais-je pas en ce dernier qu’une morale étriquée condamne à de petites salles honteuses et aux ventres ténébreux des magnétoscopes. Le film, si judicieusement nommé X, montra dès son origine ce qu’il était jusqu’alors interdit de voir : cette part des rapports humains qui devait, à soi-même et pour les autres, demeurer obscure. Voyeur, il se fit voyant du réel. Ainsi en va-t-il de toute oeuvre véritable : elle renouvelle notre manière de percevoir le monde – et d’y être -, en dévoile de nouveaux et désirables territoires et, parfois, dessine les chemins qui y conduisent.
Au demeurant, ce n’est pas la seule qualité du X.
François-Jean Lefebvre, chevalier de la Barre, Voyou de qualité
Longtemps, j’ai vécu au pied de la butte Montmartre. Une partie de mon enfance, celle des jeux insouciants, s’est écoulée dans les jardins du Sacré-Cœur. Ma mère, pour m’y conduire, empruntait la rue du chevalier de La Barre dont la pente est raide et durcit les mollets. Une main courante la divise encore aujourd’hui. Les habitants du quartier et les promeneurs y ont recours pour faciliter leur ascension ou surtout leur descente quand, le mauvais temps venu, l’asphalte devient glissant.
J’ai cru, longtemps, que La Barre était un chevalier servant qui aidait les jolies dames, les enfants et les vieillards à se tenir bien. Je trouvais judicieux que l’on -et cet on renvoyait pour moi à ces mystérieuses, grandes et puissantes personnes qui décidaient de notre vie, ou tentaient du moins de le faire – lui eût dédié une rue afin de l’honorer.
Quelques années plus tard, j’étais en première au lycée Chaptal, nous eûmes, mes camarades et moi, un étrange et attirant professeur de français dont le comportement tranchait heureusement sur celui de ses collègues. Il était avec nous libre, ironique, rigoureux et ne cherchait qu’à nous faire aimer la littérature qui, à ses yeux, ne relevait ni du jeu de société ni de l’exercice d’école. Toujours il rapportait à notre vie concrète, à nos croyances, à nos obsessions les textes qu’il nous donnait à lire et s’évertuait non à en caresser les caveaux, mais à entrouvrir leurs cercueils afin de nous donner à voir ce qu’ils recelaient. Plus tard, nous apprîmes qu’il était communiste, qu’il avait ête résistant et qu’il occupa un temps un poste de responsable culturel dans une ambassade de France installée au cœur de l’une de ces villes de l’Europe de l’Est que recouvrait alors le rouge de drapeaux prometteurs. L’homme appréciait le XVIII’ siècle. Il nous fit découvrir Laclos, l’Encyclopédie, Morelly, nous parla de Babeuf et de Saint-Just. J’ai encore en mémoire quelques-uns de leurs propos qu’il nous citait et que j’épinglais sur les murs de ma chambre: « L’insurrection est la garantie des peuples,, (Saint-Just) ; « La propriété privée ! Ce n’est quand même pas à la fin du dix-huitième siècle que nous allons soutenir ce vieil édifice ! » (Babeuf). Avant tout, et cela était pour nous un paradoxe, il aimait Voltaire et se moquait de Rousseau dont la lourdeur contrastait, nous disait-il, avec la séduisante légèreté de l’homme de Ferney. Il nous familiarisa avec quelques-unes des grandes affaires judiciaires dont s’occupa l’auteur de Zadig: Calas, Sirven, La Barre … J’en fus conduit à revoir certaines appréciations de mon enfance. Saine attitude qui rn’ amena, en premier lieu, à reprendre la ruelle que j’avais depuis quelques années délaissée. Je la grimpais avec une émotion nouvelle, agrippant cette barre dont je commençais à penser qu’elle devait aider à bien se conduire dans la vie.J’arrivais devant le Sacré-Cœur, cet édifice que nul qualificatif, même le plus vil, ne suffirait à justement qualifier. À l’intérieur du petit jardin public qui gît au pied des escaliers de la basilique était un socle qui avait supporté la statue du chevalier, installée en 1905 par un comité de libres penseurs et retirée en 1941 sur ordre du gouvernement de Vichy.
Un socle vide, comme un univers privé d’utopie. C’était dans les années soixante-dix.
Roger Vailland, éloge de la singularité
Vailland, lui, entre en hypokhâgne à Louis-le-Grand (Paris). Il y est un temps pensionnaire, avant d’emménager chez sa grand-mère, Mémé Vailland, au 7, rue Pétrarque dans le XVI c arrondissement. Le décalage est considérable entre son désir d’affranchissement et ses conditions concrètes d’existence. «J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie», lance Nizan. Éliade affirme que c’est un âge dont il s’est échappé avec bonheur. Vailland, lui, décide de faire de ses vingt ans une réussite et de « chercher sa voie au milieu d’une espèce de vertige». Il se construit, à partir de ses lectures (Spinoza surtout) et d’un usage expérimental, qu’il veut de plus en plus raisonné, de l’opium et du c9rps féminin, et il se bâtit une silhouette singulière qu’il promène dans les rues de Paris avec au bras, de temps à autre, Roger Gilbert-Lecomte (il confiera vers la fin de sa vie qu’il l’avait aimé d’amour). « Je me rappelle, écrira de Vailland Robert Brasillach, son camarade de khâgne, un garçon au visage osseux, aux cheveux longs, volontiers porteur d’une pèlerine qui lui donnait un air byronien: il commença un jour, dans le couloir qui menait à la classe d’André Bellessort, à me parler de poésie [ … ] c’était à coup sûr un des personnages les plus extraordinaires de notre classe. Il nous apportait le Manifeste du surréalisme, Poisson soluble et les poèmes de Paul Éluard. Il nous « traduisait » mot à mot Mallarmé et Valéry. Par lui nous avions communication avec d’autres camarades, une petite société anarchisante et déréglée, dont le chef principal était René Daumal. Le surréalisme lui paraissant vite démodé, il se vantait volontiers d’avoir créé un ultra-surréalisme, qu’il nommait le simplisme. À vrai dire, les différences nous paraissaient minimes, lorsqu’il nous chantait les mérites de l’acte gratuit – qu’il nommait acte pur – et de l’écriture automatique. Il était le Léocadio de Gide incarné pour nous, et bien qu’il soit rare d’admirer quelqu’un de son âge, il est exact que nous l’admirions. » Roger Vailland, en 1926-1927, a déjà des allures de maître. C’est lui, d’ailleurs, qui, en plus des plaquettes surréalistes, révèle à ses congénères Fantômas. La lecture du livre de Souvestre et d’Allain incite certains khâgneux (dont Brasillach, Paul Gadenne, Thierry Maulnier, José Lupin) à écrire Fulgur, cet extravagant roman d’aventures qui paraîtra en feuilleton dans La Tribune de l’Yonne (1927) et dont chaque chapitre est rédigé par un collaborateur différent. Brasillach fait le gros du travail. Vailland n’y collabore que pour trois chapitres. Il y est question de vierges éventrées et dévorées.
Corps nu
A de Arène
C’est un après-midi de printemps, d’été ou d’automne. L’air odore les churros ; les fanfares retiennent une musique entendue comme depuis toujours. L’arène se devine au bout de la rue. Déjà vous n’êtes plus le même. Le morne quotidien se retire de votre corps que vient habiter la désirable flagrance du drame.
Entrer dans l’arène, c’est franchir une frontière, se loger dans une parenthèse. Et entrer en résistance. La corrida, comme acte de résistance à la vulgarité, à la sédentarisation de la pensée : ce qui y advient contredit les certitudes, affole la réflexion, l’assouplit, la contraint au nomadisme, au suivi du fait.
L’arène est un œuf, et nous savons que, pour les Anciens, l’univers était un œuf. De l’arène, donc, comme d’un modèle, réduit, du monde – c’est à ce prix qu’elle peut susciter cette métaphore qu’énonce le torero poète Ignacio Sanchez Mejias qu’un toro tua sur le sable d’une plaza : « Le monde entier est une immense arène. » Voilà sans doute qui explique cette révélation fondamentale éprouvée par celui qui prend place sur les gradins : « Ici, je suis au monde. »
G Grâce
De plus en plus nombreux sont les spectateurs à demander aujourd’hui que le toro soit gracié. Dans l’espoir, sans doute, que tout finisse bien (ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants … ). Dans le rêve d’accorder l’immortalité, car que sauve+on, en définitive, quand on sauve le toro ?
Une immortalité éphémère, bien entendu. Voilà qui confirme ceci : que, comme on dit des « perles de culture », la corrida est une culture d’oxymores. L’arène : un parc à oxymores.
Et ceci encore : l’arène est le lieu où s’éprouve la grâce, laïque, du torero. Sa chance, « le seul mérite, disait un écrivain, dont on puisse légitimement se vanter ». Il y a des jours où la grâce vient.
Nîmes. Un après-midi de septembre 2010, le 18. Dans l’arène, un silence, soudain, qui la métamorphose. Dix mille corps fusionnent en un seul qui reconnaît, à son insu peut-être, l’ œuvre que bâtit Enrique Ponce. L’état de grâce ? Cet accord rythmique entre l’homme, la bête et le spectateur.
K Kitsch
Costume, fanfare, musique, nature des règles… la corrida est kitsch : c’est par là qu’elle se construit comme parenthèse -hors-lieu et hors-temps. Le kitsch la retire de l’histoire pour la coudre sur l’Histoire.
La corrida est kitsch car sa forme ne dérive pas de sa fonction. Mais la corrida doit être kitsch pour s’offrir librement à la corne : derrière l’orgie des interprétations et des paillettes, la vérité dépouillée.
La P… des Corps Saints
Peu de temps après son arrivée en France, la duchesse avait loué une maison, à une dizaine de kilomètres de la ville. A la cité et à ses lumières, elle avait préféré la plaine et ses ténébreux silences. Des vergers, une bâtisse éventrée, un terrain vague semblable à l’indifférence séparent la villa du village. Au loin, se dessine l’arc sombre des Alpilles. Par beau temps, la duchesse pouvait voir le mont Ventoux et sa tête chauve comme celle d’un ascète. Des platanes, que le vent du nord couche sur le toit, entourent la demeure. Un muret de pierres, recouvert de lichen, ferme un jardin. Des acacias l’envahissent. Souvent la duchesse y passait une partie de la nuit, dont elle aimait le calme. Une lumière filtrait de la fenêtre. Le ciel était une voûte, le jardinet une grotte. Les cigales enchantaient les bois voisins. Le bruit des feuilles froissées par le vent arrivait des grands arbres. Au-delà courait un ruisseau, de toute éternité. La duchesse s’asseyait sur un banc de pierre et méditait sur les soucis du monde. Elle cherchait l’allumette qui dissiperait les ténèbres. Elle avançait des réponses approximatives comme ces fléchettes que l’on lance et qui n’atteignent pas leur cible. Tranquille, elle attendait. Elle était certaine que la vérité ne la fuirait pas.
Vers dix heures, elle mangeait. Ses repas étaient frugaux. Elle ne se nourrissait que de salades, de légumes et de laitages, mais elle se rappelait que, dans une vie antérieure, elle avait habité un palais et qu’elle avait aimé les bois précieux, les bijoux de Bohème et les sorbets au vin de glace. Elle se demandait si ce corps serait le dernier de ceux qui avaient hébergé son âme.
» – Serais-je l’ultime mot d’une très longue histoire ? »
La tête pleine du rêve de la fin, elle espérait qu’elle n’aurait pas d’avenir et que le soleil ne se lèverait pas.
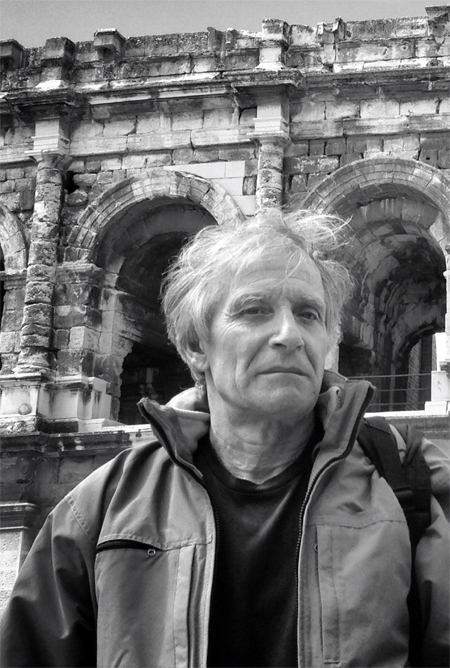 |
 |

